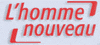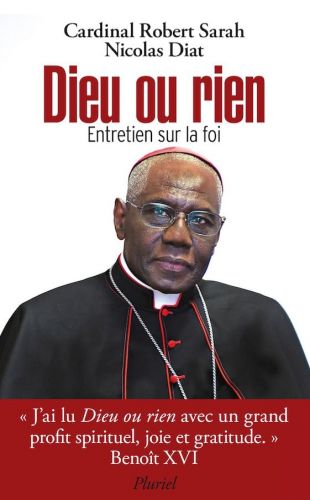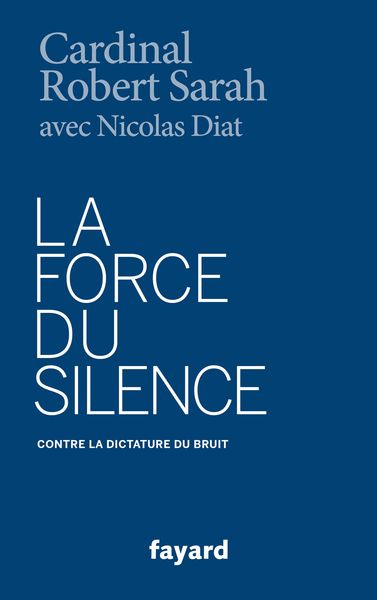Dans de nombreux cantiques aujourd’hui à la mode et qu’on chante - parfois aussi qu’on crie - à chaque grande occasion, il est question du « peuple » : « Peuple de Dieu, marche joyeux... », « Debout, peuple de Dieu... », « Peuple de baptisés, marche vers la lumière... », « Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel »... etc. Cette idée de « peuple » est apparue avec force dans un cantique très « peplum » de l'abbé David Julien - Vers toi, terre promise - qui galvanisait les assemblées dominicales des années 1960-70 : le refrain qui allait crescendo conduisait le "peuple" des paroisses à "se" chanter. Et ce fut le point de départ d’une nouvelle conception de la Liturgie : on vit apparaître de très horribles "autels" amovibles permettant, bien avant Vatican II, de célébrer systématiquement face au peuple, c’est-à-dire, dans la mentalité de beaucoup, de plus en plus « pour le peuple » et de moins en moins « pour Dieu ». Le « peuple » avait commencé par « s’auto-louanger » ; à cause d'une mauvaise interprétation du Concile, on allait pouvoir lui apprendre à « s’auto-célébrer » :
 Car c’est dans ce contexte qu’arrive le Concile qui développe le thème de la « collégialité » auquel s’ajoute le concept de « Peuple de Dieu » lequel, à partir de l’emploi linguistique, général en politique, du mot « peuple », finit par être compris, de façon plus ou moins consciente, selon l’idée marxiste de « peuple ». Le « peuple » devient alors une force permettant à chaque individu de trouver le moyen de s’opposer à un groupe dominant. Plus généralement, l’idée de « souveraineté du peuple » devra désormais s’appliquer également à l’Eglise : le « peuple » - ou ses représentants auto-proclamés - devra avoir son mot à dire au sein de « conseils », « groupes », « équipes », « comités », « instances » où l’on gère et l’on décide la catéchèse, la liturgie, la pastorale... etc. Or, la théologie montre - et façon indiscutable - que le concept de « peuple » dans l’Eglise provient d’un milieu totalement différent du notre. L’exégète allemand Werner Berg (que cite le Cardinal Ratzinger) a expliqué que l’idée de « Peuple de Dieu » est un concept biblique plutôt rare qui, de plus, n’est jamais employé pour désigner un groupe d’individus, mais pour exprimer une « parenté avec Dieu », donc une direction "verticale". L’expression se prête moins à décrire la structure d’une communauté qu’une relation enfants/Père. De ce fait, l’expression « peuple de Dieu » ne se prête pas non plus à un cri de protestation contre la structure « hiérarchique » de l’Eglise : le groupe allemand « Wir sind Kirche » (nous sommes l’Eglise) ou, plus près de nous, le « Comité catholique des baptisés francophone » qui entend « construire l’Eglise de demain » sous la houlette de Mmes Pedotti et Soupa ("théologiennes" auto-proclamées), aurait tout intérêt à revoir leur théologie en même temps que les enseignements conciliaires. Il en est de même pour de tristes individus tournant autour des revues-caniveaux telles que "Golias", "Témoignage chrétien", etc.
Car c’est dans ce contexte qu’arrive le Concile qui développe le thème de la « collégialité » auquel s’ajoute le concept de « Peuple de Dieu » lequel, à partir de l’emploi linguistique, général en politique, du mot « peuple », finit par être compris, de façon plus ou moins consciente, selon l’idée marxiste de « peuple ». Le « peuple » devient alors une force permettant à chaque individu de trouver le moyen de s’opposer à un groupe dominant. Plus généralement, l’idée de « souveraineté du peuple » devra désormais s’appliquer également à l’Eglise : le « peuple » - ou ses représentants auto-proclamés - devra avoir son mot à dire au sein de « conseils », « groupes », « équipes », « comités », « instances » où l’on gère et l’on décide la catéchèse, la liturgie, la pastorale... etc. Or, la théologie montre - et façon indiscutable - que le concept de « peuple » dans l’Eglise provient d’un milieu totalement différent du notre. L’exégète allemand Werner Berg (que cite le Cardinal Ratzinger) a expliqué que l’idée de « Peuple de Dieu » est un concept biblique plutôt rare qui, de plus, n’est jamais employé pour désigner un groupe d’individus, mais pour exprimer une « parenté avec Dieu », donc une direction "verticale". L’expression se prête moins à décrire la structure d’une communauté qu’une relation enfants/Père. De ce fait, l’expression « peuple de Dieu » ne se prête pas non plus à un cri de protestation contre la structure « hiérarchique » de l’Eglise : le groupe allemand « Wir sind Kirche » (nous sommes l’Eglise) ou, plus près de nous, le « Comité catholique des baptisés francophone » qui entend « construire l’Eglise de demain » sous la houlette de Mmes Pedotti et Soupa ("théologiennes" auto-proclamées), aurait tout intérêt à revoir leur théologie en même temps que les enseignements conciliaires. Il en est de même pour de tristes individus tournant autour des revues-caniveaux telles que "Golias", "Témoignage chrétien", etc.
Car qu’enseigne le Concile ? La Constitution « Lumen Gentium » sur l’Eglise montre que le fondement de l’Eglise n’est pas dans l’idée de « peuple » mais dans sa structure trinitaire qui fait d’elle l’instrument de Dieu pour unir à Lui les hommes et préparer le moment où « Dieu sera tout en tous » (1 Co 15, 28). Ainsi, l’expression « peuple de Dieu » employée dans bien des cantiques et qui porte à mettre Dieu de côté pour ne voir que le « peuple » n’a pas de sens au plan théologique et ecclésiologique. Et le peuple de nos assemblées dominicales le sent tout de suite, même s’il accepte de chanter ce qu’on lui dit de chanter... La crise que traverse l’Eglise, telle qu’elle se reflète dans le concept erroné de « peuple de Dieu », résulte de l’abandon de l’essentiel : Dieu. Ce qui reste alors, ce n’est que le carriérisme de quelques uns. Carriérisme auquel le Pape François a fait allusion.
Pro Liturgia



 Vos prédécesseurs, ceux qui étaient à votre place dans les années qui ont suivi immédiatement le Concile, ont gravement contribué à blesser ou à dénaturer la liturgie de l’Eglise, ce qui a eu pour conséquences la chute des vocations, l’accélération de la baisse de la pratique dominicale (« une chance pour l’Eglise » nous disait-on alors) et aussi - que vous le reconnaissiez ou pas - l’amplification de la crise lefebvriste. Aujourd’hui, Messeigneurs, les témoignages que nous recevons de presque tous les diocèses de France, soit qu’ils figurent sur vos sites internet, soit qu’ils nous sont envoyés pas des fidèles, (lettres, messages électroniques, photos...) montrent très clairement qu'au lieu de contribuer au redressement de la situation, comme le demande Benoît XVI et comme vous prétendez le faire, vous donnez le coup de grâce à cette liturgie déjà rendue moribonde dans les paroisses dont vous avez la responsabilité. Messeigneurs, n’est-il pas temps pour vous d’ouvrir les yeux ?
Vos prédécesseurs, ceux qui étaient à votre place dans les années qui ont suivi immédiatement le Concile, ont gravement contribué à blesser ou à dénaturer la liturgie de l’Eglise, ce qui a eu pour conséquences la chute des vocations, l’accélération de la baisse de la pratique dominicale (« une chance pour l’Eglise » nous disait-on alors) et aussi - que vous le reconnaissiez ou pas - l’amplification de la crise lefebvriste. Aujourd’hui, Messeigneurs, les témoignages que nous recevons de presque tous les diocèses de France, soit qu’ils figurent sur vos sites internet, soit qu’ils nous sont envoyés pas des fidèles, (lettres, messages électroniques, photos...) montrent très clairement qu'au lieu de contribuer au redressement de la situation, comme le demande Benoît XVI et comme vous prétendez le faire, vous donnez le coup de grâce à cette liturgie déjà rendue moribonde dans les paroisses dont vous avez la responsabilité. Messeigneurs, n’est-il pas temps pour vous d’ouvrir les yeux ?  Car la réalité est celle-ci : églises vides, séminaires vides, communautés diocésaines dont les effectifs fondent à vue d’œil, état alarmant des finances, raréfaction des confirmands, ignorance des fidèles sur les points élémentaires de leur religion, clergé isolé ou, pour être plus exact, qui s’est lui-même isolé à mesure qu’il se « laïcisait » en pensant être ainsi « plus proche des gens ». Cette situation est le résultat d’une pastorale qui a été menée tambour battant pendant 50 ans par des évêques cooptés au sein d’un clergé qui n’a cessé de chanter les louanges d’un Concile qu’il n’a lui-même jamais appliqué et qu’il était même interdit aux fidèles d’appliquer. C’est là une réalité qu’il n’est plus possible de dissimuler tant les témoignages sont accablants. En se couvrant abusivement de l’autorité de Vatican II, l’épiscopat de France a imposé aux fidèles - prêtres y compris - d’une façon quasi dictatoriale, pêle-mêle, l’abandon du latin et du grégorien, la célébration face au peuple, la liquidation des traditions paroissiales populaires, la concélébration systématique, les absolutions collectives,
Car la réalité est celle-ci : églises vides, séminaires vides, communautés diocésaines dont les effectifs fondent à vue d’œil, état alarmant des finances, raréfaction des confirmands, ignorance des fidèles sur les points élémentaires de leur religion, clergé isolé ou, pour être plus exact, qui s’est lui-même isolé à mesure qu’il se « laïcisait » en pensant être ainsi « plus proche des gens ». Cette situation est le résultat d’une pastorale qui a été menée tambour battant pendant 50 ans par des évêques cooptés au sein d’un clergé qui n’a cessé de chanter les louanges d’un Concile qu’il n’a lui-même jamais appliqué et qu’il était même interdit aux fidèles d’appliquer. C’est là une réalité qu’il n’est plus possible de dissimuler tant les témoignages sont accablants. En se couvrant abusivement de l’autorité de Vatican II, l’épiscopat de France a imposé aux fidèles - prêtres y compris - d’une façon quasi dictatoriale, pêle-mêle, l’abandon du latin et du grégorien, la célébration face au peuple, la liquidation des traditions paroissiales populaires, la concélébration systématique, les absolutions collectives,  Pour « ramener des fidèles » aux messes ordinaires, « il faut réintroduire davantage de silence, de hiératisme, d'intériorité, de beauté dans les vêtements liturgiques », avait encore dit Mgr Le Gall, Archevêque de Toulouse et responsable de la liturgie en France. Mais comment peut-on faire pour « ramener des fidèles » vers quelque chose qui n’a jamais existé et qui n’existe toujours pas dans nos paroisses plus de 40 ans après Vatican II (sauf très rares exceptions) ? Comment peut-on faire pour « ramener des fidèles » vers des messes « ordinaires » qui n’existent pas parce qu’on a tout bonnement interdit qu’elles puissent exister ?
Pour « ramener des fidèles » aux messes ordinaires, « il faut réintroduire davantage de silence, de hiératisme, d'intériorité, de beauté dans les vêtements liturgiques », avait encore dit Mgr Le Gall, Archevêque de Toulouse et responsable de la liturgie en France. Mais comment peut-on faire pour « ramener des fidèles » vers quelque chose qui n’a jamais existé et qui n’existe toujours pas dans nos paroisses plus de 40 ans après Vatican II (sauf très rares exceptions) ? Comment peut-on faire pour « ramener des fidèles » vers des messes « ordinaires » qui n’existent pas parce qu’on a tout bonnement interdit qu’elles puissent exister ?